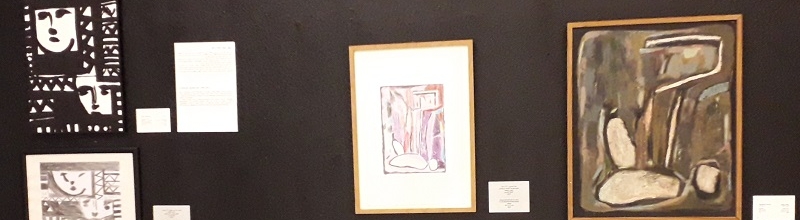Expositions
Djamel Tatah
Du 21 septembre 2013 au 21 novembre 2013 Pour la première fois, Djamel Tatah vient montrer son travail en Algérie, exactement soixante-six ans après que son père, Belkacem, fut allé vendre le sien en France, en 1947, après avoir combattu pour la libération de ce pays et de l’Europe, blessé puis démobilisé lors de la terrible bataille de Monte Cassino, où les tirailleurs nord-africains s’illustrèrent par une extraordinaire bravoure.
Au-delà de la filiation biologique, au-delà de l’état civil, c’est sans doute à ce moment, avant même que ne naisse l’artiste, en 1959, à Saint-Chamond, père de Saint-Etienne, que se constituent les éléments qui vont forger sa brillante aventure artistique.
Sa peinture, sans prétendre à aucune démonstration historique ou sociologique, concentre en elle une telle charge de passé que cela suffirait déjà à expliquer comment, avec une déconcertante sobriété de forme et de configurations, elle produit un tel effet esthétique et éthique.
Est-ce que tout art contemporain est systématiquement universel ? A priori oui.
Mais l’ont peut considérer que parmi les créations qui se réclament de ce label, certaines le sont plus que d’autres. Et, de ce point de vue, les œuvres assurément
Contemporaines de Djamel Tatah, sans craindre la redondance, peuvent être aussi qualifiées d’universelles. L’évolution de son parcours artistique le corrobore de belle manière, puisque ses peintures ont désormais traversé une bonne partie du monde pas des expositions mais aussi la renommée, trouvant partout, auprès des professionnels comme des amateurs d’art, un écho profond, une signification forte et une émotion qui dépassent les contingences géographiques et socioculturelles.
Il vient ainsi nous confirmer après tant d’autres qu’ils soient peintres dramaturges, musiciens, écrivains ou autres- que la meilleure présentation à l’universel ne peut procéder que de l’attachement, parfois extrêmement focalisée, à soi et aux seins. En art, le plus grand dénominateur commun ne se trouve pas dans la recherche forcenée ou empruntée d’un langage impersonnel, mais bel et bien, dans l’affirmation et l’interprétation de particularités profondément connues et ressenties. Cela peut paraître comme un paradoxe mais il en est ainsi depuis que l’homme s’est avisé de créer.
En l’occurrence –et plus qu’il ne peut le sembler
-l’univers de Djamel Tatah est profondément lié à son histoire personnelle, elle-même enchâssée dans l’aventure planétaire des migrations humaines, à la fois formidables et terribles.
Sa présente exposition au mama, le musée national d’art moderne et contemporain d’Alger, prend aussi la dimension d’un retour symbolique sure terre de ses ancêtres, un hommage à ses origines qu’il entend cependant mener avec autant d’affect que de professionnalisme. Ce n’est d’ailleurs pas seulement dans ce fait que Djamel Tatah signe son attachement. Toute son œuvre est parcourue par la douloureuse saga collective de l’exil.
Après s’être longtemps abreuvé des merveilles du cinéma, des œuvres du patrimoine ou de musique, curieux des expressions les plus anciennes comme des plus novatrices, brassant ses références à travers les différentes disciplines et genres, il va mener, à partir de ses jeunes années, une quête intérieure difficile mais passionnée, cherchant les voies de son accomplissement artistique.
Le début des années 1980 sera décisif. Il va intégrer à sa démarche, centrée sur les expressions artistiques nouvelles du siècle, les préoccupations liées à la deuxième génération de l’émigration. L’année 1983 est celle où il noue une amitié pérenne avec Rachid Taha, leader du groupe Carte de Séjour qui annonce, au plan musical, une prise de conscience et un mouvement revendicatif.
C’est l’année de la fameuse « Marches des beurs » qui s’ébranle de Marseille vers paris, souligne un malaise profond et suscite un mouvement créatif qui touchera fortement la musique mais concernera également la littérature (Le Thé au harem d’Archi Ahmed de Mehdi Charef, 1983 ; Le Gona du Chaâba d’Azouz Begga, 1986) ou d’autres disciplines et formes d’expression.
Djamel Tatah, proche de cet élan, le vit dans un bouillonnement intense de questions et d’hypothèses où émerge son approche de l’identité. C’est à cette période d’ailleurs qu’il s’effectuera deux séjours en Algérie, recherchant des repères originels, confrontant sa situation de fils d’émigré, né et grandi en France, à sa vision du pays-source.
En cela, son parcours ressemble à celui de son ami Rachid Taha ou encore à celui des frères Loumani, maître-verriers installés à Valbonne. Sa relation particulière avec l’Algérie, terre aimée et génitrice de sa propre histoire, va se renforcer, alimentant son inspiration à ce jour, de manière manifeste, comme peut en attester par exemple une œuvre comme les femmes d’Algérie, ou de manière latente, à travers la plupart de ses créations.
Sa situation personnelle n’est pas étrangère à cette éclosion, une situation quasi ubuesque qui va le pousser à aller au bout de ses interrogations. En effet, il partage avec tous les enfants d’émigrés algériens les tiraillements identitaires d’un entre-deux incertain entre la société de départ de leurs parents, qui a complètement changé après l’indépendance de l’Algérie et une société où ils sont nés mais où il ne trouve pas leurs marques, demeurant majoritairement à la marge.
Pour Djamel Tatah, ce tableau général se trouve en outre marqué par une particularité, plutôt rare dans sa génération. N’ayant pas formulé l’âge de seize ans une demande de nationalité française (ignorance dira-t-il, acte manqué peut-être), puisqu’a la différence de la plupart de ses « semblables », il ne dispose pas de la double-nationalité. Ni son lieu de naissance, ni l’états de service de son père durant la Guerre mondiale, ni son parcours scolaire et l’immense culture française dont il dispose, ne peuvent allez au-delà de cette détermination administrative. Il devient, dés son adolescence, le non-citoyen d’un pays natal où toute sa vie s’est construite, dont il maitrise parfaitement la longue et les usages et dont il connaît et l’histoire de l’art.
Ce n’est qu’en 1992 après avoir fondé une famille et affirmé son expression artistique, qu’il obtiendra sa ‘réintégration dans la nationalité française », expression consacrée qui n’a de sens que dans le jargon juridique mais ne peut recouvrir les profondeurs d’un parcours humain. Il a alors trente-trois ans et il peut se targuer d’avoir déjà réussi à surmonter toutes les contingences d’une telle situation en poursuivant une tel voie : celle de son engagement dans l’art, qui lui a toujours servi de laissez passer.
L’entreprise n’était pas aisée. Non reconnu autant que citoyen français, dans la difficulté d’assumer son algérianité puisque coupé du pays d’origine, il a longtemps erré dans un no man’s land intérieur, livré à un état d’isolement propre à engendrer bien des désarrois.
A contempler aujourd’hui ses personnages, on comprend d’où ils proviennent.
L’art de Djamel Tatah a été et demeure son viatique, son embarcation vers la liberté, celle de créer et de pouvoir donner la vie, de se distinguer, personnellement et socialement et, en définitive, de se voir reconnu dans toute l’amplitude de sa singularité. Vaste question que celle-là ! Gageure même dans un monde où les effets culturels profonds de la mondialisation tendant à gommer les affirmations et à estomper les diversités.
Quelle voie suivre en ces circonstances ? Se fondre dans le magma symbolique du « village global » qui n’a de village que le nom ? Ou alors, au risque d’être balayé, voire brisé, s’en tenir mordicus au désir de se distinguer, en tentant, témérairement, de placer son petit « je » dans l’immense jeu de la planète nouvelle ? Il faux du courage et de la lucidité pour aborder de front un tel dilemme et choisir, dans cette alternative, son deuxième terme : se rendre à l’évidence que la singularité est le principe fondateur et moteur de la création, comme la longue histoire de l’art l’a prouvé, du moins jusqu'à nos jours.
Djamel Tatah a eu l’audace de trancher dans ce sens. Ce faisant, il s’est engagé dans une dynamique créative fondée sur le questionnement. Qui suis-je ? Où vais-je quelle es ma place en ce monde ? De la philosophie si l’on veut, mais surtout de la douleur…
Posé à la première personne du singulier, en s’arrimant par conséquent à la propre expérience de vie du créateur, ces questions finissent pas saisir une totalité en mouvement. Car les personnages de Djamel Tatah ne sont pas seulement des autres « lui même ». Ils sont lui mais aussi de nombreux autres. Ils sont les autres vus par lui. Et lui regardant les autres. Et dans cette variété exponentielle de combinaisons ou de points de vue, ils viennent avant tout affirmer que l’artiste ne conçoit pas son œuvre hors de la présence humaine.
Ont ne peut, dès lors, s’empêcher de penser à la fameuse phrase de Térence, écrivain latin d’origineamazighe : « Rien de ce qui est humain ne m’est étranger ». Djamel Tatah la fait sienne et se l’approprie à sa manière, comme si il voulait nous dire que rien de ce qui est artistique ne pourrait être étranger à l’humain.
Dans cette approche, il n’a pas craint de recourir au figuratif en se tenant à égale distance de deux écueils : celui d’une représentation plate (au sens géométrique et symbolique) des êtres et celui d’une transfiguration excessive qui les viderait de leurs âmes. Paradoxe réussi que celui de sa figuration des personnes qui peut devenir, sous l’œil de celui qui voit, une véritable abstraction.
Car qui sont-ils enfin ces femmes et ces hommes mélancoliques, toujours sobrement vêtus, qui peuplent l’univers dépouillé de Djamel Tatah, si dépouillé qu’on ne pourrait pas même le qualifier de lunaire, privé qu’il d’aspérités, de petits reliefs etc. ?
Cet univers est celui de la vacuité, non pas celle de l’espace au lieu, mai de la représentation de ces derniers par les personnages. Voilà comment ils vivent et ressentent ce monde pourtant empli de construction, d’objets, de marchandise, de mouvements, d’agitations…L’extérieur peut être parfaitement plein et foisonnant mais apparaître totalement vide à la l’intérieur de ceux que frappe l’exil. En d’autres termes, l’exil ne serait pas le simple résultat du déplacement d’un être d’un lieu vers un autre mais un processus de dépouillement du rapport de l’être au lieu.
Il y à là toute la quintessence de la propre existence de Djamel Tatah et de la sa famille. Elle est celle aussi de l’émigration algérienne et maghrébine dans son ensemble. Elle est celle encore de toutes les migrations passées, générées par la colonisation puis les misères du sous développement. Elle est enfin celle des nouveaux exils qui touchent autant les ressortissants de pays pauvres que les cadres de pays avancés, sommés de se plier à la mobilité professionnelle.
Djamel Tatah nous informe que plus personne ne pourra s’attacher à un lieu, du moment que l’être humain n’est plus la finalité- ni d’ailleurs l’acteur- de l’immense machinerie qui s’est mise en place. En cela, il opère un raccourci fantastique entre la situation des travailleurs algériens en France. Qu’il a intimement connue à travers son père, et les questionnements éthiques universels qui nous plongent dans les univers de Franz kafka et de George Orwell.
Mais, comme tous les grands artistes, il transfigure la réalité en lui donnant-fu- elle peux agréable à voir directement- une dimension esthétique exceptionnelle.
Ses personnages sont devenus des icônes du désarroi existentiel et il a su donner de la splendeur, artistique s’entend à la vacuité qui guette la plupart des hommes et des femmes du monde.
En montrant ses œuvres à Alger, il les ramène à la matrice d’une histoire qui s’étend aujourd’hui à toute la planète. En cela, il y vient, en quelque sorte, pour nouer les liens entre son ancienne particularité et sa nouvelle universalité.
PRATIQUES
Le MAMA est ouvert tous les jours sauf le vendredi.
Toute l'équipe du MAMA sera heureuse de
vous y accueillir.
PUBLICATIONS
Les éditions du musée participent depuis 2007
à la diffusion de la connaissance de l'art moderne et l'art contemporain. Leur catalogue offre une très grande diversité de publications.